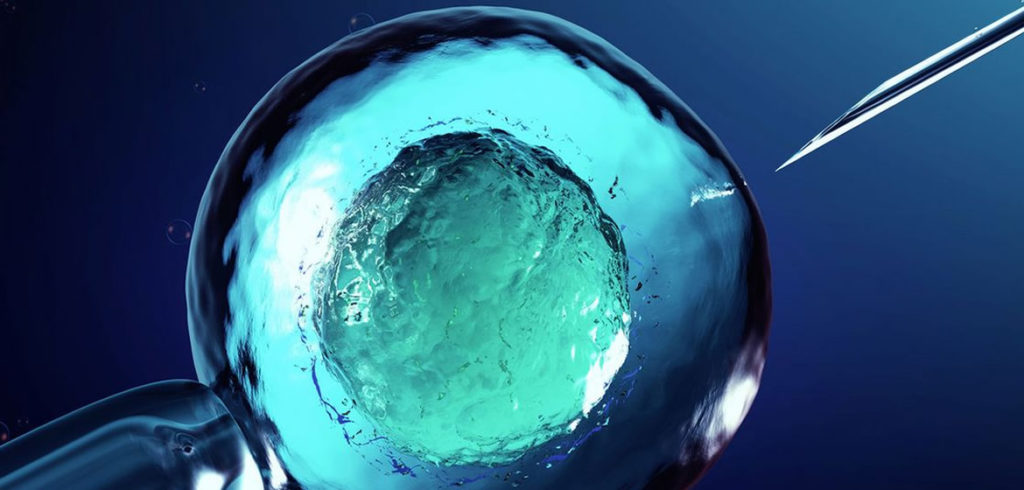PGD : Programme Gouvernance du développement
Accueil » PGD : Programme Gouvernance du développement
PGD : Programme Gouvernance du développement
Le développement des technosciences biomédicales et biotechnologiques suscite des questions bioéthiques complexes et embarrassantes qui interrogent de façon inédite les politiques de développement. Ces politiques ne peuvent être, de nos jours, mises en œuvre de manière adéquate, en négligeant ou en banalisant les technosciences qui constituent l’un des premiers facteurs du développement des sociétés contemporaines.
S’il est indéniable que les technosciences rendent les activités humaines efficaces, elles sont potentiellement sources de dérives éthiques et porteuses de germes de transformations sociales nécessaires à toutes politiques de développement. Le choix de la voie bioéthique est donc important pour une meilleure évaluation des problèmes liés aux technosciences et leurs conséquences dans le processus de développement. Cependant, une telle évaluation peut être à l’origine de polémiques du fait des valeurs éthiques différentes dans nos sociétés hétérogènes. Les réponses à ces polémiques sont, souvent, obtenues par consensus après des débats permettant de raccorder tous les points de vue.
Les meilleures réponses à la problématique éthico-technique en lien avec le développement se trouvent, pour une bonne part, dans la bioéthique. Celle-ci permet d’évaluer la conscience éthique capable d’intégrer harmonieusement les politiques de développement et les technosciences dans nos États modernes.
Pour mieux comprendre les questions bioéthiques relatives au développement et y apporter des réponses viables et durables, la Chaire Unesco de Bioéthique structure ce programme autour des trois piliers majeurs suivants :
– développer et vulgariser la culture technique afin de répondre rationnellement aux interrogations éthico-techniques qui se font profuses ;
– examiner les enjeux des technosciences biomédicales et biotechnologiques dans les mécanismes de développement pour relever, avec dignité et élégance, les défis de notre univers socio-technicien ;
– évaluer et réévaluer les valeurs, en identifiant des dilemmes éthiques, afin de proposer des paradigmes fédérateurs des technosciences et du développement.
Sous-Programmes liés
Les approches de développement ont considérablement évolué. De la place centrale qu’y avait l’Etat, il doit composer désormais avec une multiplicité d’autres acteurs. De ce fait la gouvernance du développement se révèle être d’abord un processus mais aussi le produit d’interactions multi-acteurs (institutions publiques, acteurs privés, sociétés civiles, individus, …) à différentes échelles du territoire (local, national, régional, continental et international). Elle met tous les acteurs dans une situation d’apprentissage de formes nouvelles d’action collective.
Ce programme développe des activités de recherche qui visent à suivre les interactions en marche.
Sous-Programmes liés
PGD 1 : Guerre civile et Formation de l’État : transition sécuritaire dans la reconstruction de l’Etat en Côte d’Ivoire
Ce projet porte sur le processus de construction de l’État en période de conflit armé et en situation post-conflit. Il vise une explication des stratégies mises en place par les mouvements armés pour légitimer leur existence, institutionnaliser leur pouvoir militaire et domination politique dans le cadre de la formation de l’État. Contrairement aux travaux sur la gouvernance rebelle qui portent principalement sur la vie des mouvements armés durant un conflit et leur transformation en partis politiques dans l’après-guerre, cette recherche adopte une perspective plus large en interrogeant les continuités et/ou discontinuités entre les ordres établis pendant la gouvernance rebelle et la (re)construction post-conflit de l’État. S’appuyant sur une conception wébérienne des ordres politiques en tant que passage du pouvoir brut à la domination, cette étude questionne la construction sociale de la légitimité dans les zones sous contrôle rebelle pendant le conflit, et en lien avec la formation de l’État durant le post-conflit. Basé sur une anthropologie politique de la gouvernance et des pratiques de l’État dans trois pays différents (Angola, Côte d’Ivoire, Sud-Soudan), ce projet fournit des connaissances empiriques et théoriques sur la formation de l’État en Afrique dans les contextes de consolidation de la paix.
C’est dans ce programme général que s’inscrit l’étude ivoirienne portant sur la transition sécuritaire dans la reconstruction de l’État en Côte d’Ivoire.
Suite à deux décennies de crise militaro-politique, l’État tente de restaurer son autorité, notamment sur l’armée, qui a connu un double mouvement de transformation. Primo, elle s’est décomposée au déclenchement de la rébellion de 2002 pour donner naissance à deux forces antagonistes : les Forces Nouvelles (bras militaire de la rébellion) et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), restées loyalistes et fidèles au régime de Laurent Gbagbo. Secundo, durant la crise post-électorale de 2010-2011, elle s’est recomposée au gré des rapports de forces politiques et militaires du moment pour se constituer en Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), une fusion de fait des ex-Forces Nouvelles et des ex-FDS. Ainsi, pour reconquérir sa légitimité dans ce domaine, la Côte d’Ivoire a mis en place un processus Désarmement, Démobilisation, Réintégration (DDR) et procédé à la réforme du secteur de la sécurité. En appliquant cette approche libérale de la reconstruction « post-conflit » de l’armée, le pays a connu une amélioration de l’indice de sécurité qui a d’ailleurs servi à la promotion de la croissance économique dans le cadre de la relance économique. Mais, un peu plus de cinq années, la configuration hétéroclite actuelle de l’armée et sa forte politisation se révèle de plus en plus être une source d’insécurité. Pourquoi ?
Depuis 2014, le front militaro-politique refait parler d’elle. L’armée est de nouveau confrontée à des mutineries de soldats qui revendiquent et se font payer des primes pourtant jugées « irrégulières ». Des ex-combattants s’estimant mal « démobilisés » pour n’avoir pas reçu de l’État autant d’argent que les soldats mutinés s’organisent malgré le fait qu’ils en soient politiquement dissuadés et promettent des agitations source de psychose. Tous ces facteurs contribuent à faire chuter l’indice de sécurité que l’armée est pourtant censée contribuer à améliorer. Avec ce visage de faiseur d’ordre et du désordre, l’armée ivoirienne se présente comme le centre névralgique du processus de consolidation de la paix et le paradoxe d’une transition sociopolitique et sécuritaire encore fragile. Comment alors expliquer ce paradoxe ? La réponse à cette interrogation nous conduira dans le cadre de cette recherche, à questionner la transition sécuritaire comme un « champ de possibilités » (Bayart, 1990) en l’analysant par une triple entrée : (i) à travers l’effort de reconstruction de l’appareil sécuritaire de l’État « par le haut », ce qui nous amènera à nous intéresser à la logique de la réforme de l’armée et à la production de l’indice de sécurité amélioré selon l’État ; (ii) et « par le bas », ce qui nous conduira à comprendre les articulations et/ou les désarticulations entre l’offre publique de politique sécuritaire et les mouvements d’humeur, les logiques des soldats et des ex-combattants « démobilisés ». De haut en bas et de bas en haut, nous examinerons les problèmes éthiques qui en résultent.
Source de financement : Swiss Network of International Studies ( SNIS)
Equipe : Ousmane Zina, Lazare Poamé, Francis Akindès